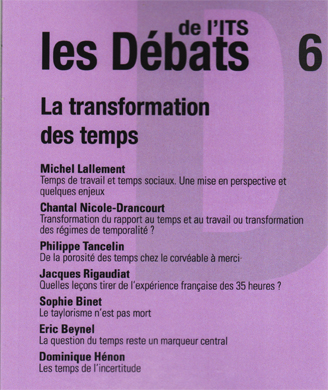La souveraineté populaire est-elle possible ? La démocratie est maintenant revendiquée haut et fort par la quasi totalité des courants politiques. Pourtant, on ne cesse de parler de l’approfondissement de la « crise démocratique » et la distance entre les citoyen(e)s et les élus s’accroît sans cesse. Quelles sont les raisons de cette situation ? Comment redonner un contenu à la notion de souveraineté populaire et au mot « démocratie » dont on ne sait plus aujourd’hui ce qu’il recouvre réellement ? Le populisme est-il la réponse à cette situation ?
Rencontre-débat organisée par la Fondation Copernic, la Fondation Gabriel Péri et l’Institut Tribune Socialiste dans le cadre de leur séminaire commun : « Qu’est-ce qui fait débat à gauche aujourd’hui ? »
Chantal MOUFFE constate que l’idée de souveraineté populaire, qui avait été déclarée obsolète à l’âge de la mondialisation, fait un retour en force dans les discours qu’on dit populistes, tant de droite (Brexit, Trump, Le Pen…) que de gauche (Sanders, Podemos, Mouvement 5 étoiles…). Pourquoi ?
Parce qu’il s’agit d’une manifestation de résistance face à la situation post-démocratique qui est le produit de trente ans d’hégémonie néo-libérale : la tension entre la tradition démocratique (souveraineté populaire, défense de l’égalité) et la tradition politique libérale (défense de l’État de droit, séparation des pouvoirs, défense des libertés) n’existe plus : tout ce qui a à voir avec la tradition démocratique a disparu. D’où une situation de « consensus » (il n’y a pas d’alternative à la globalisation néo-libérale), et dans le même temps un processus d’oligarchisation des sociétés (accroissement et concentration des inégalités).
Le moment populiste est l’expression d’une réaction contre le moment post-démocratique, un appel pour redonner un caractère démocratique à nos sociétés, refuser la liquidation des souverainetés par le néo-libéralisme.
Les populismes se construisent différemment. Le populisme de droite est construit comme une communauté nationale et sans volonté d’égalité. Le populisme de gauche a pour objectif de fédérer toute une série de demandes démocratiques, diverses, hétérogènes, afin de promouvoir l’égalité et de radicaliser la démocratie ; il est pluraliste, repose sur des chaînes d’équivalences, suppose des affects communs symbolisant non l’identité mais l’unité.
La seule façon de lutter contre le populisme de droite, c’est un populisme de gauche.
Chantal MOUFFE est philosophe. Sa réflexion s’articule notamment autour de l’idée de « démocratie radicale ». Elle a publié récemment : L’illusion du consensus (Albin Michel)