Mots-clés : front autogestionnaire, Socialisme, stratégie politique
2-8 Février 1978
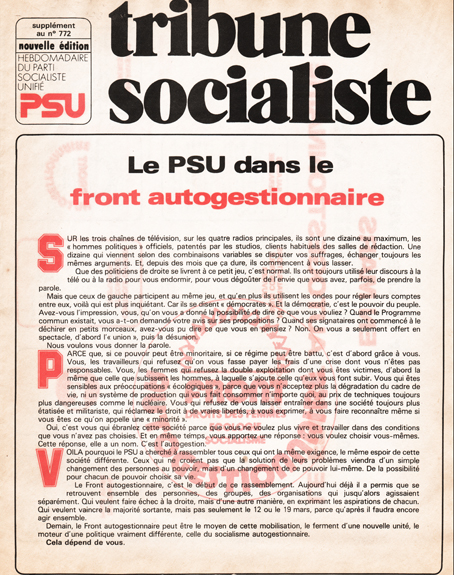 Les élections législatives des 12 et 19 Mars 1978 présentent une bipolarisation accrue de la vie politique. Le choix des électeurs se résume en une alternative entre la droite sortante (U.D.R. et R.I) et la gauche (P.C.F., P.S. M.R.G). Le programme commun n’a pu être réactualisé et l’union de la gauche est une façade. C’est dans ce contexte que le PSU veut donner la parole aux électeurs pour la construction d’une société autogestionnaire. Le front autogestionnaire est le moyen d’une mobilisation pour une politique différente. Le P.S.U appelle les électeurs à se prononcer pour le socialisme autogestionnaire. Le PSU cherche à rassembler tous ceux qui ont la même exigence, le même espoir de cette société différente.
Les élections législatives des 12 et 19 Mars 1978 présentent une bipolarisation accrue de la vie politique. Le choix des électeurs se résume en une alternative entre la droite sortante (U.D.R. et R.I) et la gauche (P.C.F., P.S. M.R.G). Le programme commun n’a pu être réactualisé et l’union de la gauche est une façade. C’est dans ce contexte que le PSU veut donner la parole aux électeurs pour la construction d’une société autogestionnaire. Le front autogestionnaire est le moyen d’une mobilisation pour une politique différente. Le P.S.U appelle les électeurs à se prononcer pour le socialisme autogestionnaire. Le PSU cherche à rassembler tous ceux qui ont la même exigence, le même espoir de cette société différente.
Mots-clés : Elections législatives, front autogestionnaire, Nucléaire, Socialisme
2 et 9 Février 1978 • Interview de Claude Bourdet par Claude Deslhiat
Claude Bourdet est candidat à Villerbanne pour le Front autogestionnaire aux élections législatives de 1978. Un front pour battre la droite, c’est-à-dire que sa candidature ne se situe pas par rapport à l’Union de la Gauche, mais plutôt, pour proposer une alternative à l’impasse du Programme Commun. Il représente les idées de lutte contre le nucléaire, contre la force de frappe, contre la politique atlantiste, pour la paix et l’écologie. Le front autogestionnaire se définit comme une autre idée de la gauche répondant aux déçus de la rupture avec le PCF et le PS par les états-majors politiques. C’est une formation de gauche, une formation de renouveau. Ce front autogestionnaire présente des candidats dans 250 circonscriptions.
Mots-clés : Elections législatives, Pouvoir populaire, Répression, Socialisme, stratégie politique
2-8 Février 1978 • Front autogestionnaire
Michel Mousel, Pascal Gollet et Victor Leduc pour le PSU, avec des responsables syndicaux, des militants de Témoignage Chrétien, les Amis de la Terre, et le mouvement pour une alternative non-violente, lancent un Appel pour la constitution d’un front autogestionnaire, afin de faire émerger une nouvelle gauche socialiste, écologiste et autogestionnaire. Les objectifs du front autogestionnaire sont la socialisation des moyens de production, le développement du contrôle ouvrier et du contrôle populaire dans les entreprises, les quartiers et les villages ; la remise en cause de la croissance pour un autre développement ; la démilitarisation de la société pour une défense populaire ; le refus du nucléaire civil et militaire ; l’autodétermination des minorités nationales ; le droit des femmes. « Nos désaccords fondamentaux avec les partis de la gauche traditionnelle ne constituent pas pour nous une raison de faire le jeu de la droite. Bien au contraire, c’est en prenant toute sa place dans le combat contre la droite que le courant socialiste, écologique et autogestionnaire pourra s’imposer à gauche, et changer ainsi la politique. »
Mots-clés : Socialisme, stratégie politique, stratégie syndicale
7 au 13 Juillet 1977 • Alain Chataignier
Syndicalisme unitaire et crise de l’Etat
Bruno Trentin, Nouveau secrétaire de la CGIL (la CGT italienne), participait le 24 juin dernier à un débat organisé par la Maison populaire de Montreuil et la revue Dialectiques sur le thème : « démocratie de base-démocratie représentative et place des associations dans le mouvement populaire à partir de l’exemple italien ». Devant 600 personnes (dont Althusser), Bruno Trentin centra son long exposé introductif sur le rôle du mouvement syndical italien face à la crise.
En fait, la CGIL, par la voix de Trentin, souhaite un modèle où l’Etat et ses institutions soient en interaction avec des organes de démocratie de base. Au cours du débat Trentin précisa sa position quant à la transition au socialisme et sa conception de l’Etat. Pour lui la transition est une transformation sans abolition de l’Etat. Il pense qu’il faut transformer l’institution parlementaire en créant de nouveaux rapports fonctionnels avec les associations de base et les organes de démocratie locale. Dans cette perspective, la stratégie révolutionnaire n’est plus un « passage obligé ». Ce que contesta vivement une partie de la salle.
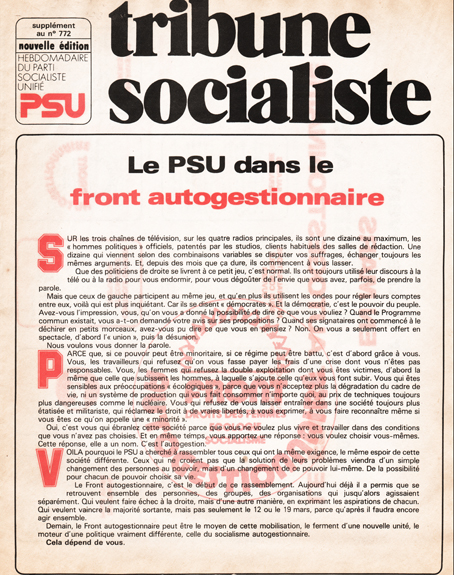 Les élections législatives des 12 et 19 Mars 1978 présentent une bipolarisation accrue de la vie politique. Le choix des électeurs se résume en une alternative entre la droite sortante (U.D.R. et R.I) et la gauche (P.C.F., P.S. M.R.G). Le programme commun n’a pu être réactualisé et l’union de la gauche est une façade. C’est dans ce contexte que le PSU veut donner la parole aux électeurs pour la construction d’une société autogestionnaire. Le front autogestionnaire est le moyen d’une mobilisation pour une politique différente. Le P.S.U appelle les électeurs à se prononcer pour le socialisme autogestionnaire. Le PSU cherche à rassembler tous ceux qui ont la même exigence, le même espoir de cette société différente.
Les élections législatives des 12 et 19 Mars 1978 présentent une bipolarisation accrue de la vie politique. Le choix des électeurs se résume en une alternative entre la droite sortante (U.D.R. et R.I) et la gauche (P.C.F., P.S. M.R.G). Le programme commun n’a pu être réactualisé et l’union de la gauche est une façade. C’est dans ce contexte que le PSU veut donner la parole aux électeurs pour la construction d’une société autogestionnaire. Le front autogestionnaire est le moyen d’une mobilisation pour une politique différente. Le P.S.U appelle les électeurs à se prononcer pour le socialisme autogestionnaire. Le PSU cherche à rassembler tous ceux qui ont la même exigence, le même espoir de cette société différente.