Mots-clés : Chômage, Emploi
6 Novembre 2015 • Denis Clerc
La pauvreté laborieuse est le résultat des différentes évolutions du marché de l’emploi. Le travailleur pauvre est celui qui travaille à un salaire très bas, ou sur des temps très partiels et/ou temporaires, en constant renouvellement, avec des périodes de non travail et, enfin, qui assure le seul revenu de la famille. Denis Clerc explicite ces évolutions et fait le constat de la précarité installée et durable. Il souligne que la pauvreté laborieuse masque une réalité sociale majeure : le dualisme d’une société dans laquelle une partie de la population est sous-prolétarisée, exclue socialement, parce qu’elle ne dispose pas des armes de plus en plus nécessaires pour affronter le marché du travail. Il constate la multiplication des emplois précaires, la diminution des emplois ne nécessitant pas de grandes qualifications, le coût élevé des services telles les gardes d’enfant et du même coup, l’impossibilité d’un deuxième emploi. Enfin il dénonce l’échec du système éducatif qui fonctionnant par écrémage engendre un laminage social avec pour conséquence le développement des revendications à court terme (défense des revenus) au détriment de la solidarité dont les exclus auraient besoin.
Denis CLERC est économiste, fondateur de la revue Alternatives économiques, et de L’économie politique. Il est membre de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale et Président de la FNARS Franche-Comté (une fédération d’associations s’occupant d’hébergement et d’insertion économique). Il a publié récemment : La paupérisation des Français (Colin, 2010) et Déchiffrer l’économie (La Découverte, 2007-2011).
22 Septembre 2015 • Patrick Cingolani
Le travail précaire, le désir d’indépendance par rapport à la société salariale est l’objet de l’étude de Patrick Congolani. Ses réflexions se fondent sur une enquête réalisée auprès d’une centaine de plus ou moins jeunes travailleurs des « nouvelles professions »(principalement dans le secteur culturel : graphiste, pigiste, infographiste, informaticien etc..). La précarité peut désigner aussi bien des discontinuités subies (des conditions d’emploi dégradées) que négociées au travers de la recherche d’un travail non totalement subordonné. C’est ce second aspect qu’il développe ici, en réinterrogeant les relations de travail au-delà d’un discours traditionnel sur l’aliénation. Il montre les ambivalences de la recherche d’autonomie, de valorisation, du refus de subordination, qui n’exclut dans les faits ni la souffrance au travail, ni l’exploitation, la concurrence, et qui repose souvent sur de nouvelles formes de solidarité familiale. Ce processus de « précarisation » est en expansion. Il nous faut donc repenser la question des relations de travail, dépasser une vision centrée sur l’emploi, et penser davantage en terme de travail, d’activité, et reposer, dans le même temps, la question du revenu du travail. Ce qui implique sans doute de nouvelles formes de mobilisation associant travailleurs, usagers, habitants …
Patrick Cingolani est professeur à l’Université Paris Diderot. Il a collaboré à la revue Les Révoltes Logiques et participé à la revue Tumultes. Il s’intéresse notamment au travail précaire et à la pauvreté, aux mouvements sociaux (chômeurs et précaires). Il a publié récemment : « Révolutions précaires. Essai sur l’avenir de l’émancipation » (2014, La Découverte), et « La précarité » (2015, PUF, Que sais-je).
Mots-clés : lien social
21 Mai 2015 • Serge Paugam
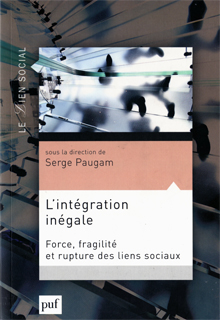 Le lien social permet le « vivre ensemble ». Il est aujourd’hui fragilisé et ne permet plus l’intégration égalitaire dans la société. Les liens qui lient les hommes entre eux dans la société sont multiples et de natures différentes mais ils apportent tous aux individus, à la fois la protection et la reconnaissance nécessaires à leur existence sociale. L’expression « compter sur » résume assez bien ce que l’individu peut espérer de sa relation aux autres et aux institutions en terme de protection. L’expression « compter pour » exprime l’attente, tout aussi vitale, de la reconnaissance. Le lien de filiation, de participation à un groupe ou à une institution (lien de participation élective), le travail (lien de participation organique) et le lien de citoyenneté sont complémentaires et entrecroisés. Ils constituent le tissu social. L’analyse de ces liens fait apparaître qu’ils se sont fragilisés et sont devenus de plus en plus inégalitaires. Ils s’entrecroisent de plus en plus difficilement au fur et à mesure que l’on descend dans la hiérarchie sociale. Il devient donc nécessaire de repenser le contenu et l’articulation de ces liens pour permettre à chacun de trouver sa place dans la société.
Le lien social permet le « vivre ensemble ». Il est aujourd’hui fragilisé et ne permet plus l’intégration égalitaire dans la société. Les liens qui lient les hommes entre eux dans la société sont multiples et de natures différentes mais ils apportent tous aux individus, à la fois la protection et la reconnaissance nécessaires à leur existence sociale. L’expression « compter sur » résume assez bien ce que l’individu peut espérer de sa relation aux autres et aux institutions en terme de protection. L’expression « compter pour » exprime l’attente, tout aussi vitale, de la reconnaissance. Le lien de filiation, de participation à un groupe ou à une institution (lien de participation élective), le travail (lien de participation organique) et le lien de citoyenneté sont complémentaires et entrecroisés. Ils constituent le tissu social. L’analyse de ces liens fait apparaître qu’ils se sont fragilisés et sont devenus de plus en plus inégalitaires. Ils s’entrecroisent de plus en plus difficilement au fur et à mesure que l’on descend dans la hiérarchie sociale. Il devient donc nécessaire de repenser le contenu et l’articulation de ces liens pour permettre à chacun de trouver sa place dans la société.
Serge Paugam est sociologue, directeur à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) de Paris, directeur de recherche au CNRS et responsable de l’Equipe de recherches sur les inégalités sociales du Centre Maurice Halbwachs. Il travaille sur la pauvreté, la précarité et la solidarité. Ses recherches s’inscrivent dans une démarche comparative, à la fois quantitative et qualitative, des formes de la pauvreté dans les sociétés modernes, notamment en Europe.
Mots-clés : lien social, Politique Économique
26 Mars 2015 • Danièle Linhart
La précarité subjective des salariés qui ont un emploi stable est le résultat d’un management capitaliste du travail qui engendre une perte de repère du salarié dans son travail. Le salarié n’a plus aujourd’hui son métier en référence de base, ses valeurs et ses connaissances mais il doit au contraire sans cesse s’adapter à de nouvelles organisations du travail, des organigrammes sans cesse différents, à des processus et à des objectifs de performance détachés des métiers. Les salariés sont autonomes et organisent leur travail dans un contexte individuel et de mise en concurrence permanente. Le travail n’est plus une expérience de socialisation mais une épreuve solitaire qui engendre des pertes de repère et une souffrance permanente. Ce management n’est pas nouveau est rappelle les professions de foi de Taylor et Ford au début de l’industrialisation. Dans ce contexte la place du syndicalisme devient de plus en plus difficile et son adaptation passe par une action sur l’ensemble de la société. Le lieu de travail n’est plus le seul lieu où on peut rencontrer les travailleurs mais le quartier peut devenir un lieu de paroles, de rencontres et d’échanges.
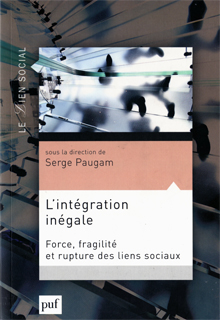 Le lien social permet le « vivre ensemble ». Il est aujourd’hui fragilisé et ne permet plus l’intégration égalitaire dans la société. Les liens qui lient les hommes entre eux dans la société sont multiples et de natures différentes mais ils apportent tous aux individus, à la fois la protection et la reconnaissance nécessaires à leur existence sociale. L’expression « compter sur » résume assez bien ce que l’individu peut espérer de sa relation aux autres et aux institutions en terme de protection. L’expression « compter pour » exprime l’attente, tout aussi vitale, de la reconnaissance. Le lien de filiation, de participation à un groupe ou à une institution (lien de participation élective), le travail (lien de participation organique) et le lien de citoyenneté sont complémentaires et entrecroisés. Ils constituent le tissu social. L’analyse de ces liens fait apparaître qu’ils se sont fragilisés et sont devenus de plus en plus inégalitaires. Ils s’entrecroisent de plus en plus difficilement au fur et à mesure que l’on descend dans la hiérarchie sociale. Il devient donc nécessaire de repenser le contenu et l’articulation de ces liens pour permettre à chacun de trouver sa place dans la société.
Le lien social permet le « vivre ensemble ». Il est aujourd’hui fragilisé et ne permet plus l’intégration égalitaire dans la société. Les liens qui lient les hommes entre eux dans la société sont multiples et de natures différentes mais ils apportent tous aux individus, à la fois la protection et la reconnaissance nécessaires à leur existence sociale. L’expression « compter sur » résume assez bien ce que l’individu peut espérer de sa relation aux autres et aux institutions en terme de protection. L’expression « compter pour » exprime l’attente, tout aussi vitale, de la reconnaissance. Le lien de filiation, de participation à un groupe ou à une institution (lien de participation élective), le travail (lien de participation organique) et le lien de citoyenneté sont complémentaires et entrecroisés. Ils constituent le tissu social. L’analyse de ces liens fait apparaître qu’ils se sont fragilisés et sont devenus de plus en plus inégalitaires. Ils s’entrecroisent de plus en plus difficilement au fur et à mesure que l’on descend dans la hiérarchie sociale. Il devient donc nécessaire de repenser le contenu et l’articulation de ces liens pour permettre à chacun de trouver sa place dans la société.