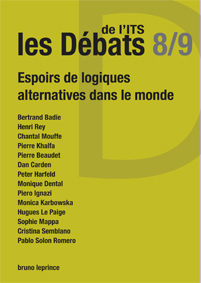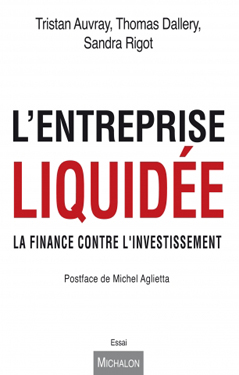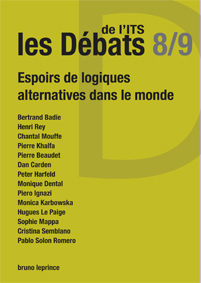
La publication d’une revue trimestrielle, éditée par l’Institut Tribune socialiste, se poursuit. Les membres du groupe Lien social, Travail et Démocratie fondé à l’initiative de Jacques Sauvageot pour organiser, animer et publier les « Débats de l’ITS » avaient à cœur de finaliser ce numéro que nous lui dédions en hommage.
La revue a pour ambition de témoigner de la contribution de l’ITS à la réflexion pour penser des alternatives au système dominant : comment analyser les mouvements économiques et sociaux qui transforment en profondeur la société, quels sont les actrices et acteurs des changements possibles et nécessaires, quelles sont les voies nouvelles de pratiques politiques associant différentes formes d’organisations et de mouvements, sur quels objectifs et dans quelles perspectives.
Ce numéro 8/9 : « Espoirs de logiques alternatives » est consacré aux croisements et confrontations des idées et des propositions pour une autre société.
Sommaire :
Bertrand Badie : En quête d’alternatives : l’état du monde
Henry Rey : Partis et mouvements : la fin d’une époque ?
Chantal Mouffe : Le défi populiste
Pierre Khalfa : Le populisme de gauche, réponse à la crise démocratique ?
Pierre Baudet : Les mobilisations populaires du printemps 2012 au Québec
Dan Carden : Jeremy Corbyn démontre qu’il y a une alternative
Peter Haberfeld : Les faiblesses de la « démocratie » américaine
Monique Dental : Women’s March Sister – Paris 21 Janvier 2017
Piero Ignazi : La crise italienne et le mouvement des Cinq Étoiles
Monika Karbowska : La crise en Europe de l’Est
Hughes Le Paige : Belgique : une gauche radicale prometteuse
Sophie Mappa : Grèce : le choc et l’éveil
Cristina Semblano : L’expérience portugaise
Pablo Solon Romero : Les processus de changement en Bolivie